Vous concentrez-vous sur les résultats ou plutôt sur le défi lui-même et le processus de développement nécessaire pour l’accomplissement d’une tâche ? La façon dont vous répondez à cette question révèle un état d’esprit qui a des implications importantes dans tous les domaines de votre vie.
Selon les pédiatres Kenneth Ginsburg et Sara Kinsman, notre culture vénère le succès et ridiculise l’échec, expliquant que l’attention portée par notre société aux « héros » (ceux qui semblent avoir atteint la perfection dans le sport, le spectacle ou d’autres domaines visibles) donne aux jeunes l’idée qu’ils doivent atteindre le sommet à tout prix. En fait, au cours des 30 dernières années, il y a eu une tendance au perfectionnisme.
« Le perfectionnisme peut être très dangereux pour les athlètes ou les personnes qui font régulièrement de l’exercice, car ils ont tendance à pousser leur corps au-delà de ses limites, précisément parce qu’ils ne supportent pas facilement l’échec », écrit le psychologue Gordon Flett. La réalité est que le perfectionnisme n’est pas seulement mauvais pour les athlètes : plusieurs études ont montré un lien entre cette façon de penser et une prédisposition aux pensées suicidaires, à des troubles psychopathologiques majeurs et à toute une série d’affections physiques.
« La mauvaise nouvelle, c’est que les perfectionnistes ne sont pas seulement obsédés par l’échec dans un domaine de leur vie ; ils détestent les erreurs, quelles qu’elles soient, et ont une mentalité de tout ou rien », explique Flett.
L’obsession de la perfection est l’ennemie de l’efficacité
Le perfectionniste est une personne qui « s’efforce d’être irréprochable, d’obtenir une création, un résultat ou une performance parfaits ». « [Les perfectionnistes] ont du mal à déléguer, même si cela signifie négliger leur santé, leurs relations et leur bien-être pour obtenir à un résultat parfait », explique la psychologue Linda Blair.
« Plus qu’une attitude ou une façon de penser, le perfectionnisme est un mode de vie », affirme Paul Hewitt, professeur à l’université de British Columbia. Comme l’explique Hewitt, derrière l’obsession du perfectionniste pour l’exécution sans faille de chaque tâche se cache une tentative de perfectionner sa propre identité.
Iskra Fileva, professeur à l’université du Colorado, décrit deux caractéristiques malsaines du perfectionnisme. Premièrement, le perfectionniste ne se concentre pas tant sur la tâche à accomplir que sur l’image qu’un échec donnerait de lui. Cela réduit évidemment son efficacité, puisque son énergie est investie dans une préoccupation qui, pour les personnes qui ne souffrent pas de perfectionnisme, est plutôt marginale.
Deuxièmement, les perfectionnistes sont animés par le désir de faire du projet sur lequel ils travaillent le plus grand succès de tous les temps, espérant se surpasser à chaque fois qu’ils en entreprennent un nouveau.
Fileva examine l’un des cas les plus célèbres de perfectionnistes qui ont saboté leur propre succès de cette manière : l’autriceElizabeth Tallent, qui a débuté avant l’âge de 30 ans avec un recueil de nouvelles publié par une maison d’édition prestigieuse et bien accueilli par les critiques littéraires. Tallent a publié deux autres recueils au cours de la décennie suivante, mais n’a plus écrit pendant plus de 20 ans. L’autrice a décrit son ambition de surpasser le succès de ses débuts par l’image de la flèche de Zénon : toujours en mouvement, ne parvenant jamais à sa destination parce qu’elle doit toujours couvrir la moitié restante de la distance entre chaque point et le point final. Ce qui était un sophisme chez le philosophe grec est une réalité dans le cas du perfectionnisme : il s’agit d’être éternellement à la recherche d’une perfection insaisissable.
Selon le révérend William Lynch, se concentrer sur soi-même plutôt que sur la tâche à accomplir, c’est perdre son temps en autocritique et en autoflagellation, raison pour laquelle il estime que la meilleure façon de procéder est de se détourner de ce qu’il appelle « notre propre bourreau ».
Accepter l’échec
« L’échec est indissociable de l’invention. Il n’est pas facultatif », déclare l’entrepreneur américain Jeff Bezos, expliquant qu’il croit en la nécessité d’échouer tôt et régulièrement jusqu’à ce que l’on réussisse.
Le problème est que évitons obstinément l’échec ; nous avons une véritable aversion pour l’échec, comme les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont montré dans leurs études que l’effet d’une perte sur nous est deux fois plus efficace que celui d’une victoire.
L’entrepreneur Jia Jiang a transformé sa peur du rejet en une entreprise florissante. Alors qu’il venait de quitter une entreprise, il s’apprêtait à lancer sa propre entreprise lorsque l’un de ses investisseurs potentiels s’est retiré, ce qui l’a amené à remettre en question la sagesse de ses décisions. Jiang a décidé de se remettre en question lorsqu’il a découvert le jeu de la « thérapie du rejet », dans lequel il a passé 100 jours à imaginer et à répéter des scénarios dans lesquels il faisait des demandes à d’autres personnes qui, comme on pouvait s’y attendre, lui répondaient négativement. À la fin du jeu, Jiang avait non seulement gagné la sympathie de plusieurs millions de personnes qui regardaient ses vidéos sur YouTube, mais aussi une résistance enviable au rejet. « La peur du rejet est bien pire que le rejet lui-même, car elle nous empêche d’essayer », déclare M. Jiang.
« En effet, personne ne peut nous rejeter plus brutalement que nous-mêmes, mais nous devons nous rappeler que les personnes qui ont changé le monde sont souvent celles qui n’ont pas laissé la peur de l’échec et du rejet dicter leurs réactions », conclut Jiang.
« Apprendre à gérer l’échec est une compétence comme une autre, qui se développe avec la pratique », écrit Rachel Simmons, directrice du Phoebe Lewis Leadership Program au Smith College. Simmons encourage ses étudiants à se poser une série de questions lorsqu’ils hésitent à s’engager dans un projet en raison du risque d’échec : Quel est la pire chose qui pourrait arriver ? Quelles sont les ressources dont je dispose pour faire face à l’échec ? Quels avantages pourrais-je tirer d’un résultat indésirable ?
« Il ne faut pas prétendre qu’un échec est quelque chose de différent, mais toujours se rappeler que l’on est plus que la défaite que l’on a subie », affirme Simmons. Une bonne stratégie pour surmonter l’échec est d’apprendre à se traiter avec compassion. Vous ne seriez pas aussi critique envers un ami qui vient d’échouer, mais vous essaieriez de l’aider à tirer les leçons de cette expérience et de regarder avec confiance vers l’avenir ; vous pouvez faire de même avec vous-même, car « l’autocompassion consiste à s’offrir la même grâce que vous accorderiez aux autres ».
Deux façons de voir le monde
« Notre relation avec le succès ou l’échec, ou à tout autre domaine de notre vie, dépend de la façon dont nous envisageons notre potentiel », explique Carol Dweck, chercheuse à l’université de Stanford. Selon l’état d’esprit fixe, l’intelligence et les compétences que nous possédons à la naissance sont gravées dans la pierre ; les personnes qui ont cet état d’esprit essaieront donc de se prouver chaque fois qu’ils le pourront. Ceux qui ont un état d’esprit flexible, en revanche, pensent qu’ils peuvent améliorer n’importe quelle compétence par l’effort et la pratique.
Dans son livre « Mindset : The New Psychology of Success », Dweck propose un exercice d’imagination. Vous êtes étudiant et, dans un cours important qui vous passionne, vous obtenez un 10 à votre examen de mi-parcours, ce qui est vraiment décevant. Vous allezau parking, où une amende vous attend pour avoir garé votre voiture dans une zone interdite. Enfin, accablé par les événements de la journée, vous appelez un ami pour lui raconter ce qui s’est passé, mais il ne montre aucun signe d’empathie pour votre chagrin et tente de vous renvoyer. Comment vous sentez-vous à la fin de la journée ?
Dweck dit avoir remarqué que les personnes ayant un état d’esprit fixe se sentent rejetées, incapables, impopulaires, mal aimées, et exagèrent l’importance d’événements désagréables mais loin d’être insupportables.
Après tout, il ne s’agit que d’un examen (d’ailleurs partiel), d’une note basse mais suffisante, d’une amende insignifiante et d’un ami qui pourrait être de mauvaise humeur pour des raisons que nous ne connaissons pas encore. En revanche, les personnes à l’esprit flexible n’attachent pas d’étiquettes négatives et ne considèrent pas la série d’événements désagréables comme une catastrophe, mais sont désireuses de relever des défis. Leurs réponses indiquent qu’elles ont décidé d’étudier davantage pour l’examen et de parler au professeur de ce qu’elles n’ont pas bien fait, de mieux se garer à l’avenir et d’avoir un moment de dialogue avec leur ami.
« La façon dont vous pensez a un impact énorme sur votre vie », écrit Dweck. Lorsqu’il s’agit d’évaluer correctement ses limites et ses capacités, les personnes ayant un état d’esprit fixe risquent d’être les plus imprécises, tandis que celles qui ont un état d’esprit flexible semblent avoir une capacité particulière à identifier leurs forces et leurs faiblesses. C’est tout à fait naturel : si vous pensez pouvoir évoluer, vous êtes plus enclin à accepter vos faiblesses.
La façon dont les deux catégories se rapportent au succès, à l’échec ou à l’effort est très différente. « Lorsque vous entrez dans un état d’esprit, vous entrez dans un nouveau monde. Dans un monde, celui des traits fixes, le succès consiste à prouver que l’on est intelligent ou talentueux. Dans l’autre monde, celui des qualités changeantes, il s’agit de se mettre au défi d’apprendre quelque chose de nouveau », explique-t-elle.
Alors qu’une catégorie considère l’échec comme un revers, un signe que l’on n’est pas intelligent ou talentueux, l’autre assimile l’échec à l’incapacité de grandir, à l’incapacité de réaliser son potentiel. Les uns saisissent toutes les occasions de s’améliorer, tandis que les autres fuient les défis, préférant ne pas montrer leurs lacunes.
« De même, le dessin (et donc le talent artistique) n’est pas une capacité magique avec laquelle on naît ou non », affirme l’enseignante Betty Edwards. On peut apprendre à dessiner, mais il faut apprendre à voir « les bords, les espaces, les relations, les lumières et les ombres, et l’ensemble ». Des autoportraits réalisés par des personnes plus ou moins douées en dessin cinq jours avant et après un court cours de dessin (et publiés dans son livre « Drawing on the Right Side of the Brain ») montrent que même dans ce domaine, considéré comme l’apanage d’une poignée de privilégiés, les compétences peuvent s’améliorer considérablement. En effet, cet exercice démontre clairement que « ce n’est pas parce que certaines personnes peuvent faire quelque chose avec peu ou pas de formation que d’autres ne peuvent pas le faire (et parfois le faire encore mieux) avec de la formation », écrit Carol Dweck. Cela ne veut pas dire que nous pourrions tous devenir Picasso ou Mozart, mais que nous sommes capables d’une croissance étonnante si nous ne sommes pas trop aveuglés par l’éclat du talent pour réaliser l’importance de l’effort.
« La façon dont nous pensons affecte également nos relations les plus importantes », déclare Dweck. Ceux qui ont un état d’esprit fixe pensent que leur partenaire idéal devrait les mettre sur un piédestal et les faire sentir parfaits, tandis que ceux qui ont un état d’esprit flexible veulent une relation qui les aide à grandir, un partenaire qui les aide à corriger leurs erreurs et les encourage à apprendre de nouvelles choses. « La façon dont les gens réagissent aux difficultés dans un mariage dépend également de leur vision de la relation », expliquent les psychologues Eva Wunderer et Klaus Schneewind : alors que certains pensent que la relation est prédestinée et que les partenaires doivent être compatibles dès le départ, d’autres croient en la croissance et surmontent ainsi plus facilement les différences qui se présentent.
Une étude publiée en août 2020 a montré que les personnes ayant un état d’esprit de croissance sont plus enclines à croire que le changement climatique peut être atténué et qu’elles sont plus enclines à prendre des mesures environnementales, précisément parce qu’elles considèrent le monde comme une entité qui peut être façonnée plutôt que comme une réalité qui ne peut être changée.
Comment nos mentalités nous aident en temps de crise
« Face au choix entre changer d’avis et prouver que nous n’en avons pas besoin, presque tout le monde s’engage dans l’épreuve », écrit l’économiste et diplomate John Kenneth Galbraith.
« Les mentalités sont constituées de croyances et peuvent donc être modifiées, même si le processus n’est pas nécessairement facile », affirme Carol Dweck, qui explique que voir les gens changer est la partie la plus gratifiante de son travail. « Le simple fait que les gens apprennent qu’il existe un état d’esprit flexible, qui présente de nombreux avantages, peut changer leur vision de la vie », ajoute-t-elle.
Notre esprit surveille et interprète constamment ce qui nous arrive, et c’est notre état d’esprit qui guide ce processus d’interprétation. Le passage d’un état d’esprit fixe à un état d’esprit flexible se traduit par un changement de monologue intérieur, d’une autocritique sévère à l’utilisation d’un retour d’information négatif et positif pour l’apprentissage et l’action constructive.
Au fur et à mesure que les résultats des recherches de Dweck sont devenus internationalement connus, certaines critiques sont apparues concernant la diffusion rapide de la théorie de l’état d’esprit de croissance, les promesses jugées exagérées, ainsi que certains échecs à reproduire les résultats des études de la chercheuse.
Lors d’un entretien avec la journaliste Alina Tugend, Dweck a déclaré que ces critiques l’avaient amenée à vouloir explorer les mentalités à un niveau encore plus profond. « Lorsque l’on passe de la théorie à la pratique, les choses prennent toutes sortes de nuances », a-t-elle expliqué. Dans le cas des élèves, par exemple, l’environnement scolaire « doit soutenir le changement de croyances et les comportements qui en découlent ». En outre, se concentrer uniquement sur l’importance de l’effort peut être un jeu perdu d’avance, en particulier dans les cultures qui pensent que les personnes douées n’ont pas besoin de travailler dur pour réussir ; l’effort n’est qu’un des outils avec lesquels l’état d’esprit flexible fonctionne, et le soutien de ceux qui nous entourent est tout aussi important. « En soi, l’effort n’est pas un simple prix de consolation ; son rôle consiste à favoriser l’apprentissage », a expliqué Dweck.
Dweck a également abordé un sujet très actuel, en se demandant si l’esprit flexible avait quelque chose à offrir au milieu de la pandémie. La chercheuse a expliqué qu’elle avait toujours refusé de parler de la crise que nous traversions parce qu’elle n’est pas une experte en santé publique et qu’elle ne voulait pas passer pour l’une de celles qui parlent de la pensée flexible au milieu des pertes subies par le pays.
Cependant, Dweck et d’autres chercheurs ont suivi le travail d’enseignants qui avaient suivi des programmes de développement de la pensée flexible et ont conclu que l’ouverture d’esprit facilitait l’adaptation à l’apprentissage en ligne. Ces enseignants se sont également concentrés sur la création d’un environnement dans lequel les étudiants pouvaient s’ouvrir aux problèmes auxquels ils étaient confrontés dans cette crise, et cette volonté de partager les peurs et les luttes personnelles fait partie du processus de développement d’un état d’esprit flexible.
La pandémie a peut-être aussi été l’une des meilleures occasions d’abandonner les fausses valeurs, la réticence à apprendre de nouvelles choses ou l’importance excessive accordée à la réussite ou à l’échec. Elle a peut-être été l’occasion de réaliser que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais aussi de célébrer la vie sous toutes ses formes, ses réalisations, ses pertes et ses âges, d’apprendre à la protéger et à la laisser couler à travers des réalités tortueuses jusqu’alors inconnues.
Surtout, c’était l’occasion de grandir dans des circonstances apparemment hostiles au progrès, parce que (du moins pour les chrétiens) la réalisation du potentiel n’a jamais été une fin en soi, mais plutôt une occasion de démontrer que la croissance est le fruit d’une union inouïe ; qu’entre un faible rameau et une vigne de la variété la plus exquise, il n’y a pas de limite à la croissance, tant que le processus se déroule sous la supervision aimante du Vigneron.
De Carmen Lăiu, rédactrice en chef de Signes des temps Roumanie et de ST Network.
Source : https://st.network/analysis/top/an-obsession-with-perfection-how-can-you-rewrite-your-mindset.html
Traduction : Tiziana Calà



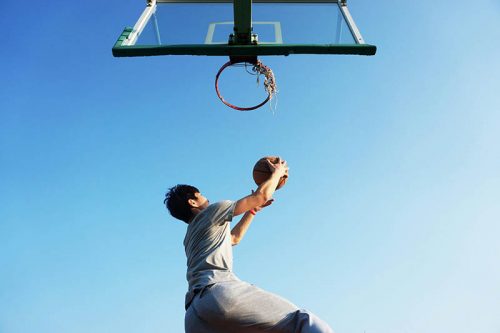


Laissez votre commentaire